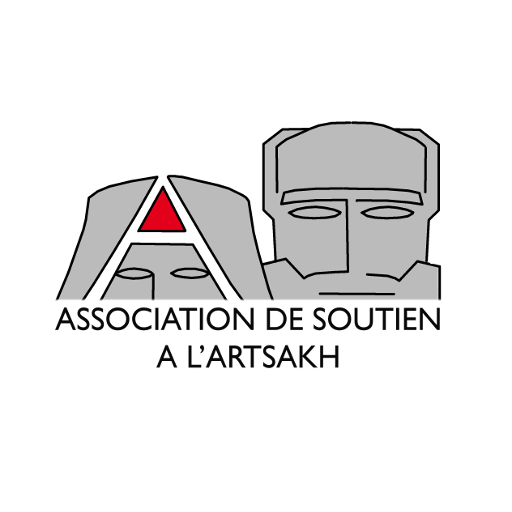Siranouche Sahakian est avocate et spécialiste des droits de l’Homme. Elle intervient également en tant qu’experte pour plusieurs organisations internationales telles que l’OSCE/ODIHR, UNICEF Arménie, le PNUD, et d’autres ONG spécialisées en justice sociale et droit européen. Engagée dans diverses initiatives législatives, projets de plaidoyer, recherches et contentieux stratégiques, elle a cofondé en 2010 l’ONG « International and Comparative Law Center » (I.C.Law – Armenia).
Quelles sont les nouvelles concernant les prisonniers et les procès en cours à Bakou ?
Les procès des prisonniers arméniens à Bakou se poursuivent. L’Azerbaïdjan détient officiellement 23 Arméniens, dont 7 ont déjà été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement, allant de 15 à 20 ans.
L’Azerbaïdjan a ouvert deux procès distincts contre 16 Arméniens, dont 8 anciens responsables du Haut-Karabakh.
Ces procès sont basés sur des preuves fabriquées et de faux témoignages, ce qui rend les procédures fondamentalement injustes.
Bien qu’officiellement déclarés « ouverts », les procès voient leur accès limité aux journalistes et observateurs autorisés par l’État, sans présence confirmée d’observateurs indépendants, de représentants juridiques ou de personnels diplomatiques. Cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à la régularité de la procédure et à un procès équitable respectant le droit international.
Quels sont les outils juridiques dont nous disposons pour obtenir leur libération ?
Nous pouvons nous appuyer sur un certain nombre d’institutions juridiques qui émettent des avis sur la légalité des détentions et le droit à un procès équitable. Parmi elles, la Cour européenne des droits de l’homme est la plus décisive, car elle peut se prononcer sur l’absence de procès équitable. La Cour européenne peut également intervenir dans les cas de détention arbitraire, en ordonnant la libération des détenus et en rendant des arrêts contraignants pour mettre fin aux détentions illégales.
Des mécanismes similaires existent aussi au sein des institutions de l’ONU. Par exemple, le groupe de travail sur la détention arbitraire peut émettre des avis qui sont politiquement et moralement contraignants pour l’État en question.
Enfin, d’autres voies juridiques sont disponibles, comme la Cour internationale de justice (CIJ). Bien qu’elle ne traite pas des violations individuelles, elle peut être appelée à vérifier le respect des obligations internationales. Dans ce contexte, des mesures ont déjà été prises dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. S’appuyer sur la Convention contre la torture (CAT) pour initier une nouvelle procédure serait un pas en avant important.
3. Quelles perspectives d’espoir avons-nous pour leur retour, et comment pouvons – nous contribuer à cet effort ici en France ?
La libération de ces prisonniers ne peut être obtenue que par une pression internationale soutenue, car l’Azerbaïdjan continue à ne pas respecter ses obligations légales. Tous les outils disponibles pour exercer une telle pression doivent être utilisés.
Les grandes puissances ont un rôle crucial à jouer, notamment en imposant des sanctions politiques et économiques ciblées aux responsables azerbaïdjanais de ces détentions illégales. En outre, l’engagement de poursuites individuelles à l’encontre de ces responsables devant la Cour pénale internationale pourrait constituer un puissant moyen de dissuasion juridique et les obliger à rendre des comptes sur les violations des droits de l’homme.